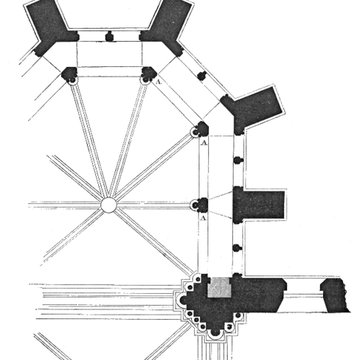Origine et histoire du Château de Réveillon
Le château de Réveillon, situé dans la commune de Réveillon dans la Marne, a été édifié entre 1607 et 1617 par Claude II d’Ancienville et sa femme Judith Raguier, sur les fondations d’un ancien château féodal dont on sait peu de choses. Une expertise de 1640 signale que le bâtiment était encore inachevé : lucarnes et menuiseries manquantes, façades et pièces intérieures non enduites, planchers et huisseries incomplets. De 1640 à 1719, la propriété changea plusieurs fois de mains, passant notamment par Michel Larcher, Jacques Galland, la famille de Fieubet de Réveillon et Philippe Millien. En 1719, René-Louis Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, fit modifier la façade côté jardin en créant un fronton sculpté représentant Minerve avec la tête de Méduse sur son bouclier, et transforma les baies du corps de logis et des ailes en ajoutant des éléments décoratifs tels que colonnes et sculptures ; ces travaux le conduisirent à vendre le domaine en 1730 à Jules-Robert de Cotte, architecte du roi. Jules-Robert de Cotte entreprit des réparations puis décora l’intérieur par des boiseries et tableaux ; il fit aussi peindre des vues des fermes du domaine à la fin du XVIIIe siècle, témoignant de l’intérêt de l’aristocratie pour l’agriculture et le progrès rural. En 1814, le château fut acquis par le notaire parisien Jean‑Front Herbelin ; son fils Jules épousa Jeanne‑Mathilde Habert, tante de la peintre Madeleine Lemaire, qui devint propriétaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Peintre réputée, surnommée par Robert de Montesquiou « l’Impératrice des roses », Madeleine Lemaire tint un salon à Paris fréquenté par des littérateurs comme Alexandre Dumas fils, Anatole France et Jules Lemaître ; Marcel Proust séjourna à Réveillon en 1894 et 1895 et s’en inspira dans plusieurs de ses ouvrages. Le château échappa largement aux destructions des deux guerres mondiales : en septembre 1914 la ligne de front ne s’établit pas durablement à proximité, malgré la présence temporaire de soldats allemands dans le parc, et en 1940 le site fut occupé par l’armée allemande. À la suite de la guerre, de nouveaux propriétaires en 1947, descendants d’anciens possesseurs, entreprirent des restaurations mais ne purent sauver l’ensemble malgré d’importants investissements, faute notamment de subventions de l’État ; depuis 1992, des propriétaires récents ont lancé une campagne de restauration importante qui a évité la ruine annoncée. Le domaine comprend des dépendances remarquables : une ferme du XVIIe siècle en appareillage de briques et pierres blanches, des communs construits par Jules‑Robert de Cotte pour abriter ses écuries et donner symétrie à la cour verte, ainsi qu’une melonnière conçue pour protéger et chauffer les fruits grâce à des systèmes de murs. Le pigeonnier, mentionné déjà en 1697 et restauré en 1992, présente une charpente de chêne de quarante tonnes et une couverture en tuiles et plomb ; il se compose d’une salle basse voûtée destinée au stockage et d’une salle haute destinée aux pigeons, avec environ 3 500 boulins maçonnés, ce qui indique que le domaine ne possédait pas le droit de justice. Une grille d’honneur de style Louis XV, attribuée à Jules‑Robert de Cotte, ferme la cour à l’ouest. Le château a été classé au titre des monuments historiques le 8 juin 1948, et l’ensemble du domaine — parc, jardins à la française, potager et verger — a été classé le 9 août 1996 ; le jardin figure par ailleurs au pré‑inventaire des jardins remarquables. Les jardins, dont la création est attribuée à Jacques Galland et à Marguerite Le Camus au XVIIe siècle, forment un parc de cinq hectares qui comprend, face à l’est, un jardin à la française bordé d’une double allée de marronniers blancs et ponctué d’une aire surélevée ceinturée d’une charmille ; à l’ouest, une cour verte pavée et flanquée de deux pavillons assure la liaison entre le château, la ferme, les communs et l’extérieur. Au‑delà des murs d’enceinte s’étendent, du nord au sud‑ouest, un carrousel, un grand potager arrosé par la rivière de Réveillon, deux bosquets surélevés qui amplifient les perspectives et un vaste verger, composant l’ensemble paysager historique du domaine.