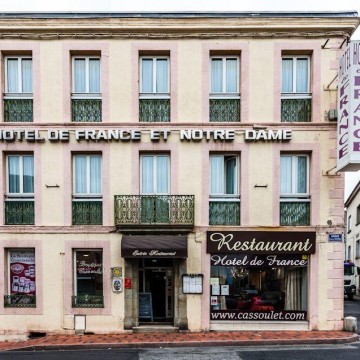Origine et histoire
Le canal du Midi, anciennement appelé « canal royal de Languedoc », relie Toulouse à la mer Méditerranée et forme, avec le canal latéral à la Garonne, la liaison dite « canal des Deux-Mers » entre l'Atlantique et la Méditerranée. Conçu par l'ingénieur Pierre‑Paul Riquet d'après des plans transmis à Colbert en 1662, le projet reçut l'autorisation royale en octobre 1666. Les travaux débutèrent en 1667 sur le tronçon Toulouse–Naurouze ; la première partie fut mise en eau en 1672 et le canal achevé définitivement à la fin de 1682, Riquet n'en voyant pas l'achèvement puisqu'il mourut durant le chantier. Ouvrage d'art majeur du XVIIe siècle, il a transformé les circulations fluviales du Midi en résolvant le problème d'alimentation en eau du seuil de Naurouze grâce à un système de rigoles et de réservoirs captant les eaux de la Montagne Noire. Le succès technique du système repose notamment sur le lac de Saint‑Ferréol et sur les rigoles de la montagne et de la plaine qui dirigent les eaux collectées vers Naurouze.
Le bien inscrit au patrimoine mondial comprend le tronçon principal entre Toulouse et l'étang de Thau (environ 241 km), un embranchement long de 36,6 km entre Moussan et Port‑la‑Nouvelle, les rigoles d'alimentation (82 km), le canal de Saint‑Pierre (1,6 km) et un court raccord de 0,5 km vers l'écluse ronde d'Agde. Canal à bief de partage, il présente un versant Atlantique d'environ 57 km et un versant Méditerranée d'environ 189 km, le seuil de Naurouze constituant le point le plus élevé. Les caractéristiques opérationnelles se situent autour d'une profondeur moyenne de mouillage de 2 m (minimum 1,8 m), d'un tirant d'eau garanti de 1,4 m et d'une largeur au miroir variant entre 16 et 20 m.
Classé parmi les plus anciens canaux européens encore en service, le canal du Midi a d'abord servi au transport de marchandises et de voyageurs avant d'être progressivement reconverti, à partir du XXe siècle, en voie majeure de tourisme fluvial. Il comporte un ensemble remarquable d'ouvrages d'art : au total 400 ouvrages sur le canal des Deux‑Mers, dont 328 pour la section Midi, avec notamment 63 écluses, 126 ponts, 55 aqueducs, sept ponts‑canaux, six barrages, un tunnel et des réalisations singulières comme les écluses de Fonseranes et l'écluse ronde d'Agde. L'alimentation en eau et la gestion hydraulique ont été complétées par des travaux d'amélioration conduits après l'ouverture, notamment sur les rigoles et le barrage de Saint‑Ferréol.
La construction mobilisa une main-d'œuvre organisée et spécialisée, employée par Pierre‑Paul Riquet sans recours massif à la corvée ; le chantier fut dirigé par une administration propre et accompagné de techniques d'observation et d'expérimentation, comme la rigole d'essai. Le financement résulta d'un partage des coûts entre l'État, la province et l'entrepreneur, la propriété et l'exploitation ayant été concédées à Riquet et à ses descendants selon les modalités prévues par l'ordonnance royale. L'État devint propriétaire par la loi de 1897, et la gestion est aujourd'hui confiée à Voies navigables de France depuis 1991.
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, le canal et son système d'alimentation bénéficient d'un cadre de protection et d'une gouvernance partenariale renforcée depuis 2016, avec un plan de gestion adopté en 2021 qui définit objectifs et actions pour la période 2020‑2027. Le maintien du patrimoine arboré et la gestion des platanes atteints par le chancre coloré constituent des enjeux récents : la maladie, détectée en 2006, a conduit à des campagnes d'abattage et à des plans de remplacement par d'autres essences adaptées.
Aujourd'hui, le canal est surtout fréquenté par les plaisanciers et génère une activité touristique importante, avec plusieurs centaines de milliers de passagers et des retombées économiques estimées ; il accueille aussi des pratiques sportives et culturelles le long de ses berges et reste un élément essentiel des ressources en eau et d'irrigation locales. Le canal du Midi demeure, par son système hydraulique, ses ouvrages et son histoire technique, un exemple majeur d'ingénierie et d'aménagement paysager reconnu au plan national et international.